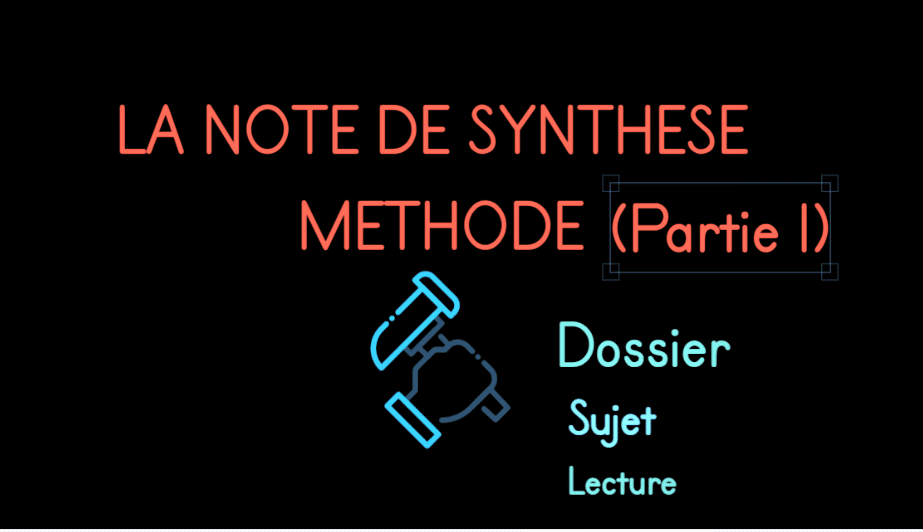Un exemple complet et corrigé de note de synthèse. Pour que cette fiche corrigée remplisse son but pédagogique, revoyez d’abord, la fiche méthodologique (ICI). Revoyez également la manière de synthétiser un dossier (ICI). La totalité du dossier ainsi que le corrigé sont également disponibles en téléchargement PDF ci-après.
1. Le dossier
| À partir des documents du dossier, vous rédigerez une note de synthèse objective et synthétique. Document 1 « Pour la littérature-monde en français », Michel Le Bris et Jean Rouaud, Le Monde des livres, 16/03/2007. Document 2 « La francophonie, une réalité oubliée », Abdou Diouf, Le Monde, 19/03/2007. Document 3 « La littérature-monde en français, un bien commun en danger », entretien d’Alain Mabanckou par Laure Garcia et Claire Julliard dans Libération, 14/07/2007. Document 4 « Contre le manifeste ̋ Pour la littérature-monde en français ̋ », Alexandre Najjar, Le monde des livres, mars 2007. |
Document 1 « Pour la littérature-monde en français »
Plus tard, on dira peut-être que ce fut un moment historique : le Goncourt, le Grand Prix du roman de l’Académie française, le Renaudot, le Femina, le Goncourt des lycéens, décernés le même automne à des écrivains d’outre-France. Simple hasard d’une rentrée éditoriale concentrant par exception les talents venus de la « périphérie », simple détour vagabond avant que le fleuve revienne dans son lit ? Nous pensons, au contraire : révolution copernicienne. Copernicienne, parce qu’elle révèle ce que le milieu littéraire savait déjà sans l’admettre : le centre, ce point depuis lequel était supposée rayonner une littérature franco-française, n’est plus le centre. Le centre jusqu’ici, même si de moins en moins, avait eu cette capacité d’absorption qui contraignait les auteurs venus d’ailleurs à se dépouiller de leurs bagages avant de se fondre dans le creuset de la langue et de son histoire nationale : le centre, nous disent les prix d’automne, est désormais partout, aux quatre coins du monde. Fin de la francophonie. Et naissance d’une littérature-monde en français.
Le monde revient. Et c’est la meilleure des nouvelles. N’aura-t-il pas été longtemps le grand absent de la littérature française ? Le monde, le sujet, le sens, l’histoire, le « référent » : pendant des décennies, ils auront été mis « entre parenthèses » par les maîtres-penseurs, inventeurs d’une littérature sans autre objet qu’elle-même, faisant, comme il se disait alors, « sa propre critique dans le mouvement même de son énonciation ». Le roman était une affaire trop sérieuse pour être confiée aux seuls romanciers, coupables d’un « usage naïf de la langue », lesquels étaient priés doctement de se recycler en linguistique. Ces textes ne renvoyant plus dès lors qu’à d’autres textes dans un jeu de combinaisons sans fin, le temps pouvait venir où l’auteur lui-même se trouvait de fait, et avec lui l’idée même de création, évacué pour laisser toute la place aux commentateurs, aux exégètes. Plutôt que de se frotter au monde pour en capter le souffle, les énergies vitales, le roman, en somme, n’avait plus qu’à se regarder écrire.
Que les écrivains aient pu survivre dans pareille atmosphère intellectuelle est de nature à nous rendre optimistes sur les capacités de résistance du roman à tout ce qui prétend le nier ou l’asservir…
Ce désir nouveau de retrouver les voies du monde, ce retour aux puissances d’incandescence de la littérature, cette urgence ressentie d’une « littérature-monde », nous les pouvons dater : ils sont concomitants de l’effondrement des grandes idéologies sous les coups de boutoir, précisément… du sujet, du sens, de l’Histoire, faisant retour sur la scène du monde – entendez : de l’effervescence des mouvements antitotalitaires, à l’Ouest comme à l’Est, qui bientôt allaient effondrer le mur de Berlin.
Un retour, il faut le reconnaître, par des voies de traverse, des sentiers vagabonds – et c’est dire du même coup de quel poids était l’interdit ! Comme si, les chaînes tombées, il fallait à chacun réapprendre à marcher. Avec d’abord l’envie de goûter à la poussière des routes, au frisson du dehors, au regard croisé d’inconnus. Les récits de ces étonnants voyageurs, apparus au milieu des années 1970, auront été les somptueux portails d’entrée du monde dans la fiction. D’autres, soucieux de dire le monde où ils vivaient, comme jadis Raymond Chandler ou Dashiell Hammett avaient dit la ville américaine, se tournaient, à la suite de Jean-Patrick Manchette, vers le roman noir. D’autres encore recouraient au pastiche du roman populaire, du roman policier, du roman d’aventures, manière habile ou prudente de retrouver le récit tout en rusant avec « l’interdit du roman ». D’autres encore, raconteurs d’histoires, investissaient la bande dessinée, en compagnie d’Hugo Pratt, de Moebius et de quelques autres. Et les regards se tournaient de nouveau vers les littératures « francophones », particulièrement caribéennes, comme si, loin des modèles français sclérosés, s’affirmait là-bas, héritière de Saint- John Perse et de Césaire, une effervescence romanesque et poétique dont le secret, ailleurs, semblait avoir été perdu. Et ce, malgré les oeillères d’un milieu littéraire qui affectait de n’en attendre que quelques piments nouveaux, mots anciens ou créoles, si pittoresques n’est-ce pas, propres à raviver un brouet devenu par trop fade. 1976-1977 : les voies détournées d’un retour à la fiction.
Dans le même temps, un vent nouveau se levait outre-Manche, qui imposait l’évidence d’une littérature nouvelle en langue anglaise, singulièrement accordée au monde en train de naître. Dans une Angleterre rendue à sa troisième génération de romans woolfiens – c’est dire si l’air qui y circulait se faisait impalpable -, de jeunes trublions se tournaient vers le vaste monde, pour y respirer un peu plus large. Bruce Chatwin partait pour la Patagonie, et son récit prenait des allures de manifeste pour une génération de travel writers (« J’applique au réel les techniques de narration du roman, pour restituer la dimension romanesque du réel »). Puis s’affirmaient, en un impressionnant tohu-bohu, des romans bruyants, colorés, métissés, qui disaient, avec une force rare et des mots nouveaux, la rumeur de ces métropoles exponentielles où se heurtaient, se brassaient, se mêlaient les cultures de tous les continents. Au cœur de cette effervescence, Kazuo Ishiguro, Ben Okri, Hanif Kureishi, Michael Ondaatje – et Salman Rushdie, qui explorait avec acuité le surgissement de ce qu’il appelait les « hommes traduits » : ceux-là, nés en Angleterre, ne vivaient plus dans la nostalgie d’un pays d’origine à jamais perdu, mais, s’éprouvant entre deux mondes, entre deux chaises, tentaient vaille que vaille de faire de ce télescopage l’ébauche d’un monde nouveau. Et c’était bien la première fois qu’une génération d’écrivains issus de l’émigration, au lieu de se couler dans sa culture d’adoption, entendait faire œuvre à partir du constat de son identité plurielle, dans le territoire ambigu et mouvant de ce frottement. En cela, soulignait Carlos Fuentes, ils étaient moins les produits de la décolonisation que les annonciateurs du XXIe siècle.
Combien d’écrivains de langue française, pris eux aussi entre deux ou plusieurs cultures, se sont interrogés alors sur cette étrange disparité qui les reléguait sur les marges, eux « francophones », variante exotique tout juste tolérée, tandis que les enfants de l’ex-empire britannique prenaient, en toute légitimité, possession des lettres anglaises ? Fallait-il tenir pour acquis quelque dégénérescence congénitale des héritiers de l’empire colonial français, en comparaison de ceux de l’empire britannique ? Ou bien reconnaître que le problème tenait au milieu littéraire lui-même, à son étrange art poétique tournant comme un derviche tourneur sur lui-même, et à cette vision d’une francophonie sur laquelle une France mère des arts, des armes et des lois continuait de dispenser ses lumières, en bienfaitrice universelle, soucieuse d’apporter la civilisation aux peuples vivant dans les ténèbres ? Les écrivains antillais, haïtiens, africains qui s’affirmaient alors n’avaient rien à envier à leurs homologues de langue anglaise. Le concept de « créolisation » qui alors les rassemblaient, à travers lequel ils affirmaient leur singularité, il fallait décidément être sourd et aveugle, ne chercher en autrui qu’un écho à soi-même, pour ne pas comprendre qu’il s’agissait déjà rien de moins que d’une autonomisation de la langue.
Soyons clairs : l’émergence d’une littérature-monde en langue française consciemment affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, signe l’acte de décès de la francophonie. Personne ne parle le francophone, ni n’écrit en francophone. La francophonie est de la lumière d’étoile morte. Comment le monde pourrait-il se sentir concerné par la langue d’un pays virtuel ? Or c’est le monde qui s’est invité aux banquets des prix d’automne. A quoi nous comprenons que les temps sont prêts pour cette révolution.
Elle aurait pu venir plus tôt. Comment a-t-on pu ignorer pendant des décennies un Nicolas Bouvier et son si bien nommé Usage du monde ? Parce que le monde, alors, se trouvait interdit de séjour. Comment a-t-on pu ne pas reconnaître en Réjean Ducharme un des plus grands auteurs contemporains, dont L’Hiver de force, dès 1970, porté par un extraordinaire souffle poétique, enfonçait tout ce qui a pu s’écrire depuis sur la société de consommation et les niaiseries libertaires ? Parce qu’on regardait alors de très haut la « Belle Province », qu’on n’attendait d’elle que son accent savoureux, ses mots gardés aux parfums de vieille France. Et l’on pourrait égrener les écrivains africains, ou antillais, tenus pareillement dans les marges : comment s’en étonner, quand le concept de créolisation se trouve réduit en son contraire, confondu avec un slogan de United Colors of Benetton ? Comment s’en étonner si l’on s’obstine à postuler un lien charnel exclusif entre la nation et la langue qui en exprimerait le génie singulier – puisqu’en toute rigueur l’idée de « francophonie » se donne alors comme le dernier avatar du colonialisme ? Ce qu’entérinent ces prix d’automne est le constat inverse : que le pacte colonial se trouve brisé, que la langue délivrée devient l’affaire de tous, et que, si l’on s’y tient fermement, c’en sera fini des temps du mépris et de la suffisance. Fin de la « francophonie », et naissance d’une littérature-monde en français : tel est l’enjeu, pour peu que les écrivains s’en emparent.
Littérature-monde parce que, à l’évidence multiples, diverses, sont aujourd’hui les littératures de langue françaises de par le monde, formant un vaste ensemble dont les ramifications enlacent plusieurs continents. Mais littérature-monde, aussi, parce que partout celles-ci nous disent le monde qui devant nous émerge, et ce faisant retrouvent après des décennies d’interdit de la fiction ce qui depuis toujours a été le fait des artistes, des romanciers, des créateurs : la tâche de donner voix et visage à l’inconnu du monde – et à l’inconnu en nous. Enfin, si nous percevons partout cette effervescence créatrice, c’est que quelque chose en France même s’est remis en mouvement où la jeune génération, débarrassée de l’ère du soupçon, s’empare sans complexe des ingrédients de la fiction pour ouvrir de nouvelles voies romanesques. En sorte que le temps nous paraît venu d’une renaissance, d’un dialogue dans un vaste ensemble polyphonique, sans souci d’on ne sait quel combat pour ou contre la prééminence de telle ou telle langue ou d’un quelconque « impérialisme culturel ». Le centre relégué au milieu d’autres centres, c’est à la formation d’une constellation que nous assistons, où la langue libérée de son pacte exclusif avec la nation, libre désormais de tout pouvoir autre que ceux de la poésie et de l’imaginaire, n’aura pour frontières que celles de l’esprit.
Liste des signataires : Muriel Barbery, Tahar Ben Jelloun, Alain Borer, Roland Brival, Maryse Condé, Didier Daeninckx, Ananda Devi, Alain Dugrand, Edouard Glissant, Jacques Godbout, Nancy Huston, Koffi Kwahulé, Dany Laferrière, Gilles Lapouge, Jean-Marie Laclavetine, Michel Layaz, Michel Le Bris, JMG Le Clézio, Yvon Le Men, Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Anna Moï, Wajdi Mouawad, Nimrod, Wilfried N’Sondé, Esther Orner, Erik Orsenna, Benoît Peeters, Patrick Rambaud, Gisèle Pineau, Jean-Claude Pirotte, Grégoire Polet, Patrick Raynal, Jean-Luc V. Raharimanana, Jean Rouaud, Boualem Sansal, Dai Sitje, Brina Svit, Lyonel Trouillot, Anne Vallaeys, Jean Vautrin, André Velter, Gary Victor, Abdourahman A. Waberi.
Michel Le Bris et Jean Rouaud, Le Monde des Livres, mars 2007.
Document 2 La francophonie, une réalité oubliée
Les Français doivent faire l’effort de se penser dans un ensemble linguistique dynamique et créateur de diversité culturelle.
A la tête de l’organisation de la francophonie depuis quatre ans, je ne parviens toujours pas à m’expliquer, ni à expliquer aux francophones militants qui vivent sur d’autres rivages, le désamour des Français pour la francophonie. Désamour, désintérêt, méconnaissance ? Il est vrai que les médias français, légitimement préoccupés par les crises qui ébranlent le monde et par la politique européenne, ne trouvent que peu de place à lui consacrer, si ce n’est une fois tous les deux ans, à l’occasion du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, et encore…
La francophonie ne recueille d’ailleurs pas plus les faveurs du monde académique ou de la recherche universitaire puisqu’elle n’a fait l’objet que de vingt-cinq articles de politique internationale en l’espace de trente-six ans, et de deux thèses de science politique depuis 2001 ! Désintérêt évident et, par voie de conséquence, méconnaissance réelle.
Je m’explique mal que les universitaires, les chercheurs, les étudiants en science politique ou en relations internationales n’éprouvent pas le besoin ou la curiosité de se pencher sur cette organisation de la francophonie qui compte désormais soixante-huit Etats et gouvernements répartis sur l’ensemble des continents. Je m’explique mal qu’évoquant les crises et les conflits qui secouent l’Afrique, on omette de mentionner la part déterminante que prend la francophonie aux efforts de paix et de reconstruction dans cette région, et dans d’autres. Je m’explique mal qu’évoquant la bataille qui s’est livrée à l’Unesco autour de la Convention sur la diversité culturelle, on omette de signaler le rôle décisif de la francophonie dans ce bras de fer.
Faut-il voir dans ces omissions le fait que l’on continue – singulièrement parmi les élites et les intellectuels – à la percevoir à travers le prisme d’idées aussi fausses que reçues : un combat dépassé pour la défense de la langue française, contre l’anglais ! Un avatar du colonialisme ! Ces formules péremptoires sont plus graves qu’il n’y paraît, et l’honnêteté intellectuelle voudrait que l’on cherche à connaître avant de juger et de condamner.
UNE NOUVELLE GUERRE DE CENT ANS
Je n’ose croire que ceux dont le métier est de penser et de créer veuillent réduire le combat de la francophonie pour le respect et la promotion de la diversité des langues et des cultures à une nouvelle guerre de Cent Ans. Il ne s’agit pas de lutter pour ou contre la prééminence de telle ou telle langue. Il s’agit de faire en sorte que la vie de l’homme sous l’effet d’une standardisation ne se transforme en un désert de redondances et de monotonie, ou que les identités culturelles ne deviennent « meurtrières ». Il s’agit de construire une communauté mondiale où la recherche de convergences, d’alliances, d’interactions entre les aires de civilisation l’emportera sur les volontés hégémoniques. Et ce dessein, les francophones le revendiquent avec fierté.
Enfin, je regrette que ces idées reçues éclaboussent de leur mépris – sans le vouloir sans doute – tous ces pays que rien ne rattache au passé colonial de la France et qui ont choisi d’adhérer à la francophonie. La langue française n’appartient pas aux seuls Français, elle appartient à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi de l’apprendre, de l’utiliser, de la féconder aux accents de leurs cultures, de leurs imaginaires, de leurs talents. Et les francophones d’autres contrées attendent des Français qu’ils ouvrent plus largement leurs manuels scolaires, leurs collections, leurs médias au talent de ces écrivains, de ces chanteurs, de ces cinéastes, de ces artistes qui ont fait le choix de créer en français.
Vous comprendrez donc que j’applaudisse à deux mains lorsque je lis, dans « Le Monde des livres » (du 16 mars), le brillant hommage de quarante-quatre écrivains à la « littérature-monde » en français ! Nous partageons tous le même éclatant et stimulant constat, à savoir que « diverses sont aujourd’hui les littératures de langue française ». Il est clair, aussi, que nous partageons le même objectif, celui « d’un dialogue dans un vaste ensemble polyphonique ». Mais vous me permettrez de vous faire irrespectueusement remarquer, mesdames et messieurs les écrivains, que vous contribuez dans ce manifeste, avec toute l’autorité que votre talent confère à votre parole, à entretenir le plus grave des contresens sur la francophonie, en confondant francocentrisme et francophonie, en confondant exception culturelle et diversité culturelle. Je déplore surtout que vous ayez choisi de vous poser en fossoyeurs de la francophonie, non pas sur la base d’arguments fondés, ce qui aurait eu le mérite d’ouvrir un débat, mais en redonnant vigueur à des poncifs qui décidément ont la vie dure.
Les Français ne savent pas encore assez tout ce qu’ils peuvent offrir à la francophonie, et surtout tout ce qu’elle peut leur offrir. J’espère que viendra bientôt le jour où il sera évident pour un Français de se présenter en se disant normand, français, européen et francophone, sans crainte d’apparaître « réac » ou ringard !
Abdou Diouf, président de l’Organisation Internationale de la Francophonie jusqu’en 2014, Le monde, 19 mars 2007.
Document 3 « La littérature-monde en français, un bien commun en danger »
Parlez-nous de la naissance de ce manifeste ?
Alain Mabanckou : L’idée a germé en Afrique, au moment de l’édition 2006 du festival Etonnants voyageurs de Bamako, au Mali. Avec Michel Le Bris, Abdourahmane Waberi et Jean Rouaud, nous avons discuté du paysage littéraire d’expression française et avons jeté les bases de ce qui allait être le Manifeste des 44 écrivains pour une «littérature-monde». Un an plus tôt, à l’occasion du salon du livre, j’avais évoqué dans Le Magazine littéraire et Le Monde ce que j’entendais par «littérature francophone», un ensemble vaste et éclaté et dont les tentacules s’étendent sur cinq continents, la littérature française étant une littérature nationale. L’idée était d’imaginer celle-ci comme un élément de la littérature francophone et non, comme c’est le cas, de toujours définir les lettres francophones comme une dépendance de la littérature française. Nous devons aller vers la rumeur du monde, et de ce fait, les thèses que défend Edouard Glissant dans son œuvre théorique sont d’une actualité frappante. Le terme de «littérature-monde» s’est alors imposé, et nous avons commencé à ébaucher les grandes lignes du projet et à rechercher les écrivains qui partagent cette idée d’une ouverture au monde. Les plus grands auteurs d’expression française des cinq continents ont aussitôt répondu à cet appel, et certains d’entre eux ont même donné un texte pour notre livre collectif.
Avez-vous voulu signer l’acte de mort de la francophonie ?
A. M. : La francophonie telle qu’elle se présente actuellement est une institution éminemment politique. Elle ne comprend que peu d’artistes et d’écrivains, ce qui constitue une aberration en soi. Il semble qu’un auteur comme Boualem Samsal, qui écrit en français, n’a pas été invité au salon de la francophonie parce que son pays, l’Algérie, n’est pas un membre de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Notre manifeste n’est cependant pas une croisade contre l’institution elle-même, comme l’a cru à tort le président Abdou Diouf. Nous avons besoin d’organisations de ce type pour la rencontre des cultures et l’avènement d’une identité fondée sur notre amour commun de la langue française et le respect des langues locales, particulièrement dans les anciennes colonies françaises. Il demeure que la francophonie est vue aujourd’hui comme la continuation de la politique étrangère de la France par un moyen détourné. Les écrivains français n’ont pas été invités au salon du livre de mars 2006 consacré aux littératures francophones alors que la France, jusqu’à preuve du contraire, est un membre de l’Organisation internationale de la francophonie. C’est là une preuve que nous sommes toujours dans la logique déplorable du ghetto, même si les intentions louables des organisateurs étaient de mettre en avant les «voix venues d’ailleurs». Nous devons apprécier l’écrivain francophone parce qu’il est avant tout un écrivain, et non un auteur qui se contenterait de perpétuer la langue française. La défense de la langue n’est pas son rôle exclusif.
Daniel Picouly : Je n’ai pas signé le manifeste, mais ce discours me convient. Alain et moi ne sommes pas opposés sur le fond. Le concept de «littérature-monde» a le mérite de réveiller ce qui était en sommeil sous forme de malaise ou de frustration. N’empêche, la «littérature-monde» est une mauvaise réponse à une bonne question. La francophonie oui ; le ghetto non. C’était le titre et la teneur de l’article d’Alain dans Le Monde au moment du salon du livre de Paris. Cela me convenait. Cela disait un attachement critique, une vigilance. Tout n’était pas à jeter. Car Alain et moi sommes attachés à certaines institutions que nous avons pratiquées comme les Alliances françaises, par exemple. Mais hélas, à l’heure actuelle, au regard de ses ambitions, l’institution apparaît défaillante, ne serait-ce que financièrement. Par ailleurs, il serait désolant aujourd’hui que la francophonie donne l’impression de se résumer à un rassemblement de chefs d’Etat une fois par an, «entre soi». Le sommet de la francophonie est perçu comme une organisation pyramidale dont rien ne redescend. Bien sûr, il me paraît également absurde que l’Algérie n’adhère pas à l’OIF, mais c’est son droit et une position souveraine. Mais que l’on n’invite pas un auteur pour cette raison ne pourrait que démontrer le racornissement politique d’une institution.
Les mots vivent, le terme de francophonie a vécu, il est connoté péjorativement. Est-il «sauvable» ? Peut-on encore l’investir ? Je m’étonne de sa faible capacité à mobiliser des énergies pour sa défense. J’avoue que je n’avais pas réagi au manifeste «littérature-monde» car je croyais à une future déferlante de contributions plus autorisées. Je ne suis pas signataire du manifeste car je refuse la mise à mort de la francophonie sur la seule mise en évidence de ses défauts et carences. Je crains que le mouvement «littérature-monde» ne devienne qu’une structure parallèle sans effet d’interpellation réel sur l’institution. Pourquoi renoncer à demander des comptes aux organisations censées nous représenter ? Il faut interroger cette démarche qui consiste à doublonner une structure jugée défaillante d’une nouvelle en espérant que l’autre se nécrose. Une sorte de pontage après infarctus de la francophonie. Et que trouve-t-on de l’autre côté du pont ? Une nouvelle académie ? Un nouveau prix ? Une nouvelle revue ? De quelle couleur, le nouvel habit, le nouveau bandeau ?
Le terme de francophonie lui-même ne recouvre-t-il pas des réalités plus administratives que culturelles ?
A. M. : Ce terme sème beaucoup de confusion, sans doute parce qu’il a été conçu dès le départ par Onésime Reclus, au XIXe siècle. Ce géographe craignait alors l’affaiblissement de l’empire colonial français, et il a imaginé la francophonie comme une réponse. A ce titre, il a initié le désir de créer un ensemble plus vaste. Toutefois, son discours était lié à une certaine idée de l’expansion coloniale. Et c’est ce lien – aujourd’hui plus subtil – qui doit être coupé afin que n’importe quel créateur en langue française se sente libre, et non pas sous l’emprise d’une quelconque idéologie expansionniste. Le terme de francophonie est devenu péjoratif et a, pour beaucoup de francophones, une connotation post-coloniale.
D. P. : D’accord pour admettre que l’on puisse percevoir des résonances post-coloniales dans la francophonie. Mais on ne peut pas dire que l’actualité littéraire aille dans le sens d’une marginalisation de la littérature francophone. Voir les prix littéraires de la rentrée, dont cinq ont été attribués à des auteurs d’outre-France, dont Jonathan Littel, Nancy Huston et Alain Mabanckou. On peut m’objecter qu’il ne s’agit là que d’une aberration statistique et qu’on reviendra vite à un étiage plus conforme à la réalité. Alors, qu’est-ce qui a changé au point de provoquer l’émergence de ce manifeste ? Un accès de faiblesse ? Le contraire, pour moi. C’est la force et l’exposition de cette littérature qui lui permet de se faire entendre. Comme s’il existait une masse critique pour être audible dans ce tintamarre médiatique. Par exemple : les personnalités signataires refusent d’être étiquetées, rangées par genre. Je trouve cette réaction très émotionnelle, elle semble oublier qu’on ressemble tous à ces vieilles valises étiquetées de partout. Selon le mode de classement en librairie – bien pratique par ailleurs -, je me retrouve en BD, jeunesse, polar, roman historique, roman tout court, récit de jeunesse. Ailleurs, je suis romancier d’origine antillaise, populaire, de banlieue, du 9-3. Que sais-je ? Je pourrais m’en offusquer, car je sais que tout classement est discriminatoire, qu’il induit une différence de statut et de considération. Expérience personnelle : dans le même grand salon, je ne suis pas logé dans le même hôtel selon que je suis venu signer un livre de jeunesse ou un roman. Anecdotique ? Je n’en suis pas certain. Désolant ? Certainement. Peut-être que d’ici quelques années, des jeunes liront Ahmadou Kourouma ou Alain Mabanckou avant Chateaubriand. Les lecteurs se retrouvent dans une littérature universelle, quelle qu’en soit l’origine. Bien sûr, je dois batailler avec les correcteurs pour maintenir mes tournures populaires, comme toi, Alain, tes «congolismes». J’espère le lecteur plus intéressé par l’énergie de la langue que par son classicisme normé.
Le débat porte aussi sur la place de la littérature française dans le monde. Paradoxalement, la francophonie semble mieux comprise aux Etats-Unis qu’en France, puisqu’il existe là-bas des quotas d’auteurs francophones traduits et étudiés, dont un quart de «Français de France».
A. M. : Les Américains ont eu l’humilité d’admettre qu’ils n’étaient pas les dépositaires de la culture mondiale. Ils ont ainsi multiplié les appels aux experts et ont pris en compte l’expérience. Aujourd’hui, les plus grands médiévistes sont américains. Les étudiants américains sont plus sensibilisés sur les lettres francophones que leurs collègues français. La plupart des universités américaines ont des départements d’études francophones – ce qui n’est pas encore le cas en France. Les «études africaines» se développent aussi. On y étudie l’histoire, la politique et l’anthropologie africaines, qui apportent un éclairage sur la littérature de ce continent et permettent ainsi des traductions d’auteurs africains d’expression française. Aujourd’hui, nous nous plaignons parce que le texte d’expression française est peu traduit en anglais. Une majorité de ces traductions concerne des oeuvres d’écrivains d’expression française qui ne sont pas nés en France. Toute l’oeuvre de Kourouma est traduite et connue dans les universités anglophones. Sans doute les Américains ne se retrouvent-ils plus dans le roman français contemporain, trop replié sur lui-même, un constat que faisait d’ailleurs Richard Millet dans Harcèlement littéraire (Gallimard, 2005).
D. P. : Je trouve amusante l’idée que ces écrivains «pas nés en France» installent une tête de pont pour natifs et qu’on assiste à ce genre de renversement. Les institutions françaises semblent également avoir cédé à la fatalité de l’hégémonie et avoir abandonné l’idée d’une défense vigoureuse de la francophonie, tellement elles paraissent résignées à la domination de l’anglais. Le bilinguisme devrait faire partie intégrante de la réflexion. On a le sentiment que ces dernières années, le combat culturel est frappé par le grand renoncement. C’est significatif, je n’ai pas eu l’impression d’entendre parler de culture pendant la présidentielle, ni de la place du français dans le monde. Ce débat sur la «littérature-monde» en français a au moins pour vertu de montrer l’attachement très vif à un «quelque chose de commun en danger», de provoquer entre amis un échange autour de la francophonie, et d’interpeller les politiques sur le sujet. Au fait, Mesdames et Messieurs les politiques, qu’allez-vous faire ?
(1) Des écrivains comme Tahar Ben Jelloun, Edouard Glissant, Dai Sijie, Abdourahman A. Waberi, Anna Moï ou Jacques Godbout y prônent une langue française «libérée de son pacte exclusif avec la nation». Gallimard, sous la direction de Jean Rouaud et de Michel Le Bris, Pour une littérature-monde, collectif, 352 p.
Entretien par Laure Garcia et Claire Julliard d’Alain Mabanckou dans Libération, 14/07/2007.
Document 4 Contre le manifeste « Pour la littérature-monde en français »
Le manifeste « Pour une littérature-monde en français », publié dans Le Monde du 15 mars 2007, est affligeant à un double titre : il constitue d’abord un « sabordage » de la part d’écrivains francophones qui, au lieu de brandir l’étendard de la francophonie, célébrée lors du dernier Salon du livre et défendue avec ardeur par des millions de personnes, tentent de la « ringardiser » et sèment le doute dans les esprits, alors même que la plupart d’entre eux font partie d’institutions francophones ou de jurys de prix francophones. Il comporte, d’autre part, des erreurs inacceptables qu’il est nécessaire de dissiper : le fait que les principaux prix français couronnent cette année des écrivains « d’outre-France » n’est nullement une « révolution copernicienne ». Ce phénomène n’est pas nouveau : au cours des quinze dernières années, plusieurs auteurs étrangers d’expression française, dont Amin Maalouf et Tahar Ben Jelloun, ont obtenu d’importantes distinctions littéraires. Pourquoi s’en émouvoir tout à coup ? Aussi est-il aberrant de prendre les prix littéraires pour seul critère, comme si ces prix déterminaient le présent et l’avenir de la littérature française, alors qu’ils sont – on l’a vu cette saison – de plus en plus décriés. Du reste, comment peut-on, en partant de ce constat, annoncer la « fin de la francophonie » alors que ces prix, à supposer qu’ils représentent vraiment le baromètre de la littérature contemporaine, témoignent au contraire de la vitalité de la francophonie ? La notion de « littérature-monde en français » ne veut rien dire, elle n’est qu’une périphrase de la francophonie qui est l’ensemble de ceux qui, aux quatre coins du monde, ont le français en partage. « Il a expliqué l’eau par l’eau », dit un proverbe libanais. C’est de cela, précisément, qu’il s’agit ici. Car qu’est-ce que la francophonie sinon la langue française « ouverte sur le monde et transnationale », c’est-à-dire la définition même qu’on veut donner à la « littérature-monde en français » ? Et qu’est-ce que la francophonie sinon cette « constellation » revendiquée par le manifeste et le refus d’un pacte « exclusif » avec la nation française au profit d’un pacte universel pour la défense d’une langue française menacée, mais toujours synonyme de liberté et d’ouverture sur le monde ? Affirmer, d’autre part, que « personne ne parle le francophone, ni n’écrit en francophone » est tout aussi insignifiant, car personne n’a jamais prétendu que la francophonie représente une sorte d’espéranto. La francophonie n’est pas une langue à part, elle n’est pas, ou n’est plus, un « avatar du colonialisme ». Au Liban, la langue française était parlée avant le Mandat français et se porte toujours très bien, soixante ans après le départ des troupes françaises du Levant. Un Libanais, un Québécois ou un Algérien qui s’exprime en français est francophone, au même titre qu’un Français de Paris, de Bretagne ou de Marseille. Tous appartiennent à une même famille ayant une langue et des valeurs en commun. Cela ne suffit-il pas ? Pourquoi faut-il, au nom d’une vision réductrice de la francophonie, remettre en question ce que Senghor et nombre de personnalités majeures de notre temps ont réussi à bâtir dans un formidable élan de solidarité ? Pourquoi parler de « modèles français sclérosés » et déprécier la littérature française contemporaine, qui compte encore, Dieu merci, d’excellents romanciers, dans le seul but de mieux illustrer l’apport inespéré des écrivains venus d’ailleurs, alors qu’il aurait suffi de dire que ceux-ci peuvent apporter à la littérature française des idées, des sujets, des vocables nouveaux ? Le sentiment que nous avons, nous autres, écrivains francophones vivant à l’étranger, c’est que nos collègues qui s’installent en France, dès lors qu’ils décident de s’intégrer dans la vie française, ne supportent plus qu’on ne les assimile pas aux auteurs français et revendiquent la « normalité », alors que l’enjeu n’est pas là : la francophonie est notre dénominateur commun, elle n’a rien de honteux, elle n’a pas besoin d’être intégrée, puisqu’elle intègre déjà, et que, loin de diviser, elle réunit. Que nous importe l’exemple britannique ! Il existe entre les pays qui ont le français en partage d’autres considérations, historiques, affectives, humaines, qui font de la francophonie un concept spécifique, inimitable, qu’il serait faux de vouloir reconsidérer par référence au modèle anglo-saxon qui complexe encore nos intellectuels et qui cherche à gommer, au nom de la mondialisation prônée par l’Amérique, la diversité culturelle et le dialogue interculturel que favorise justement la francophonie. Les personnalités qui ont signé le manifeste en question ont sans doute voulu insister sur l’apport des écrivains venus d’ailleurs à la langue française et leur initiative est, en soi, très louable. Mais en souscrivant aux syllogismes et aux analyses approximatives du rédacteur du manifeste, ils sont tombés dans le piège du dénigrement de la francophonie, alors que celle-ci, devenue une réalité incontournable dotée d’institutions de plus en plus efficaces, n’est pas en contradiction avec l’idée de « littérature-monde » et ne conduit nullement à marginaliser les écrivains étrangers d’expression française. Les auteurs du manifeste ont cru bon de reprocher au roman français de « se regarder écrire ». C’est le même reproche que nous leur faisons aujourd’hui.
Alexandre Najjar, Le monde des livres, mars 2007.
2. Note de synthèse exemple
Note de synthèse exemple de corrigé sous forme de plan détaillé
Problématique : peut-on envisager un consensus autour du terme « francophonie » aujourd’hui ?
Introduction :
Le terme francophonie désignait à l’origine une collectivité établie autour d’une langue commune. Ce n’est que dans les années 1960 que le vocable réfère à une réalité historique postcoloniale. Ainsi, le mot « francophonie » suscite la polémique comme en témoignent le manifeste « Pour la littérature-monde en français », publié le 16 mars 2007 qui rassemble quarante-huit signataires et l’entretien accordé par Mabanckou et Picouly qui reviennent sur les origines de cette invocation d’une nouvelle voie, « La littérature-monde en français, un bien commun en danger », publié dans Libération le 14 juillet 2007. Au rebours, Alexandre Najjar intitule sa réponse « Contre le manifeste ̋ Pour la littérature-monde en français ̋ » publié dans le monde des livres de mars 2007 tandis qu’Abdou Diouf, président de l’OIF signe un plaidoyer dans Le Monde intitulé « La francophonie, une réalité oubliée » le 19 mars 2007. Peut-on dès lors envisager un consensus autour de la « francophonie » aujourd’hui ? Le terme apparaît de prime abord comme éminemment plurivoque. Il se définit dans une tension entre le centre et la dispersion. Quels sont alors les enjeux du choix de l’étiquette « francophone » ou « littérature-monde » ?
I)La francophonie : un terme plurivoque
A/Un terme historique et politique ?
- Doc 1 francophonie = « dernier avatar du colonialisme » de même, le doc 3 montre un effet de ghetto en donnant l’exemple du salon du livre de 2006 auquel les écrivains français ne sont pas conviés.
- Doc 2 : récusation par Abdou Diouf d’un terme postcolonial car certains signataires ne sont pas liés à la France par un quelconque lien historique. Alexandre Najjar va plus loin dans le doc 4 lorsqu’il développe l’image de la famille pour s’en référer à la francophonie.
B/ Un terme culturel ?
- Les signataires du manifeste à travers la métaphore de l’acte de décès récusent toute restriction langagière « personne ne parle le francophone » Najjar s’insurge contre cet argument car, pour lui, il n’a jamais été question d’attribuer à la francophonie une fonction de langue construite pour faciliter une communication universelle. ou géographique « langue d’un pays virtuel », dans le doc 3 Mabanckou reprend cette dimension géographique à travers l’image de la pieuvre qui se répand sur les 5 continents.
- Diouf déplore une confusion entre exception culturelle et diversité culturelle, reprise par l’écrivain libanais qui retourne contre les signataires du manifeste l’accusation d’égocentrisme dont ils affublaient les écrivains français.
Conclusion transition : Le terme francophonie provoque la polémique en raison du fait que les locuteurs ne réfèrent pas toujours à une même réalité.
II) La francophonie : centre et pluralité
A/Du centre et de ses périphéries : un rapport à la France
- Le manifeste évoque « une révolution copernicienne » qui s’affranchirait du patronage de la littérature française, de même le président de l’OIF évoque un désintérêt des Français, y compris des universitaires vis-à-vis de la francophonie. Mabanckou considère que le terme est connoté négativement tandis que Picouly dresse un constat différent et récuse toute marginalisation.
- Quant à Najjar il refuse toute normalisation, il écarte toute initiative d’intégration.
B/Une diversité sous-jacente
- Le manifeste fait le constat d’une identité plurielle, constat repris dans la phrase d’ouverture de Diouf tandis que Najjar met en évidence une francophonie comme dénominateur commun.
- Cette pluralité est défendue à travers le modèle anglo-saxon mis en avant dans le manifeste mais décrié par Diouf tout comme Najjar pour qui ce modèle américain vise davantage à réduire les différences qu’à les laisser s’exprimer.
Conclusion transition : La réflexion sur l’intégration ou le respect de l’altérité inhérente à la francophonie renvoie au choix terminologique et à ses implications.
III) Francophonie ou littérature-monde ?
A/ Simple désaccord terminologique…
- Le manifeste revendique une nouvelle étiquette « littérature-monde » pour s’affranchir définitivement du poids colonial avec la France et, comme le stipule Mabanckou dans doc3, s’ouvrir au monde, D. Picouly concède à son interlocuteur un diagnostic juste mais une mauvaise réponse en voulant ériger un organisme parallèle au premier. Najjar constate que la tournure n’est qu’une périphrase concurrente du terme « francophonie ». _ bataille inutile qui n’apporte rien de nouveau ou…
B/…ou dissension politico-économique
- Doc 1 et 3 renvoie à un système mondialisé : « Le monde revient » qui impliquerait de lisser les aspérités de la différence. Diouf promeut la diversité, il évoque dans un chiasme un apport culturel réciproque entre francophone et français. Najjar note, dans la même veine, un dialogue entre les cultures. Un consensus est donc envisagé dans les docs 2 et 4
Conclusion : Le choix terminologique est lourd de sens car il suppose une véritable interrogation sur le traitement accordé à l’altérité : la considère-t-on pour ce qu’elle offre de nouveau ? La réduit-on au semblable ?
Conclusion :
Les auteurs œuvrent tous pour un développement des écritures plurielles, affranchie du poids de la littérature française mais le consensus autour de la « francophonie » est rendu impossible précisément parce que le terme renvoie à des réalités trop diverses. Il est donc investi différemment par les deux partis qui reflètent deux attitudes face à l’altérité qui s’efforce d’être intégrée ou qui est laissée à sa différence.
Nous espérons que cette fiche « note de synthèse exemple » a pu vous aider dans votre travail. N’hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires si une note entièrement rédigée pourrait être utile. Merci de votre lecture!
Pour aller plus loin: